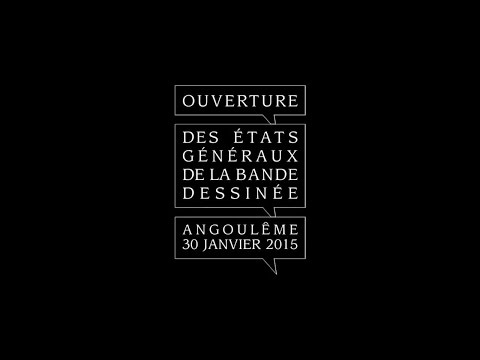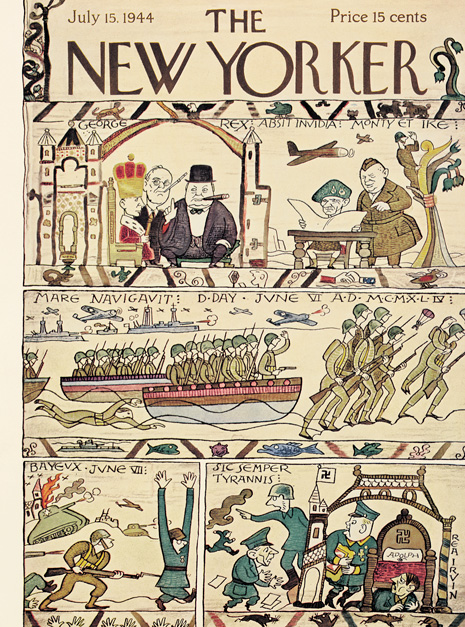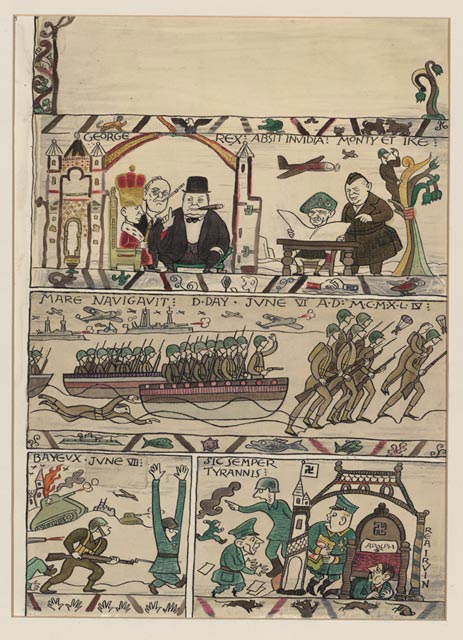Savez-vous que la liste des signataires pour le référendum d’initiative partagée sur l’Aéroport de Paris sera rendue publique ?
 Extrait des mentions légales du site : « La liste des électeurs soutenant une proposition de loi est accessible par ordre alphabétique des noms des électeurs […] Cette liste, accessible aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms et sa commune d’inscription sur les listes électorales »
Extrait des mentions légales du site : « La liste des électeurs soutenant une proposition de loi est accessible par ordre alphabétique des noms des électeurs […] Cette liste, accessible aux seules fins de consultation, précise pour chaque électeur soutenant la proposition de loi son nom, son ou ses prénoms et sa commune d’inscription sur les listes électorales »
Cela veut donc dire qu’amis, ennemis, partis politiques, publicitaires, employeurs, organisations à but non démocratique, tous pourront vérifier qui pense quoi. Charmant.
Bien sûr, la loi interdit de constituer à partir de là un fichier politique de citoyens français… mais on sait que ça ne gênera pas les plus malhonnêtes ni les plus dangereux, et pas plus les entreprises ou les puissances étrangères…
Les lois et décrets qui organisent le référendum d’initiative partagée, qu’on doit aux précédentes législatures et gouvernements, ont donc abouti à un résultat simplement scandaleux en termes de fichage public des citoyens.
Depuis le lancement de la campagne de signature, j’hésite donc. Au-delà même de la question de la privatisation d’une entreprise stratégique et rentable pour l’État, je suis plutôt favorable à une démocratie qui consulterait plus souvent sa population. Mais, franchement, j’ai du mal à envisager d’aller m’inscrire de moi-même dans un fichier politique public.
D’un autre côté, depuis des mois, j’hésite aussi à parler de ce risque, car c’est un bon moyen de participer à plomber ce premier essai de référendum pétitionnaire, d’autant plus qu’on sait que la barre des 4,7 millions de signataires sera très difficile à atteindre.
Je sais que quelques députés me lisent. Il serait vraiment sérieux de construire un nouveau RIP, qui n’obligerait pas les citoyens à auto-dénoncer publiquement leurs opinions politiques. Et quitte à faire cela, à réfléchir à tous les modèles existants, de la Suisse à l’Angleterre en passant bien sûr par les propositions liées au RIC. Sans passer à l’ochlocratie, le pouvoir de l’ochlos, la foule, il est tout de même urgent que la démocratie représentative écoute mieux le dêmos, le peuple.
Pour en savoir plus : www.numerama.com
Les mentions légales : www.referendum.interieur.gouv.fr
La liste des signataires : www.referendum.interieur.gouv.fr
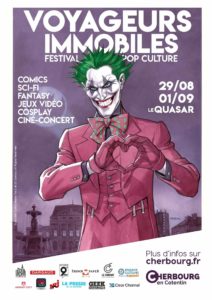

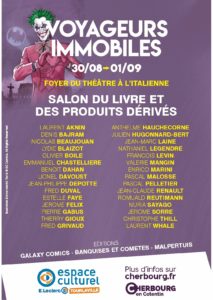


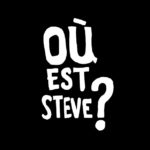 Notre société est en train de s’habituer à l’horreur. Hier, c’est probablement le cadavre de Steve Maia Caniço qui a été retrouvé dans la Loire. P
Notre société est en train de s’habituer à l’horreur. Hier, c’est probablement le cadavre de Steve Maia Caniço qui a été retrouvé dans la Loire. P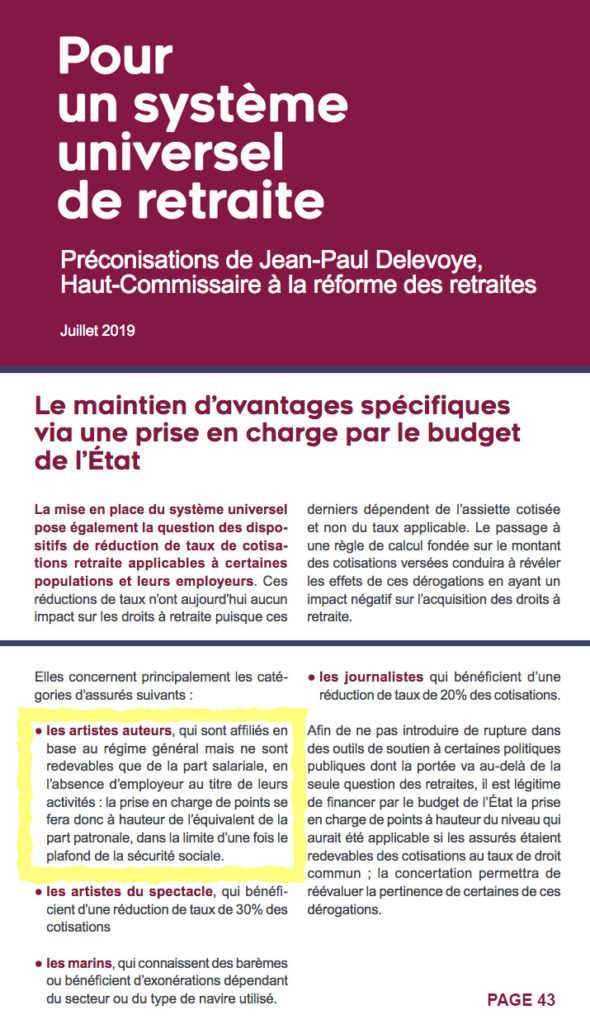
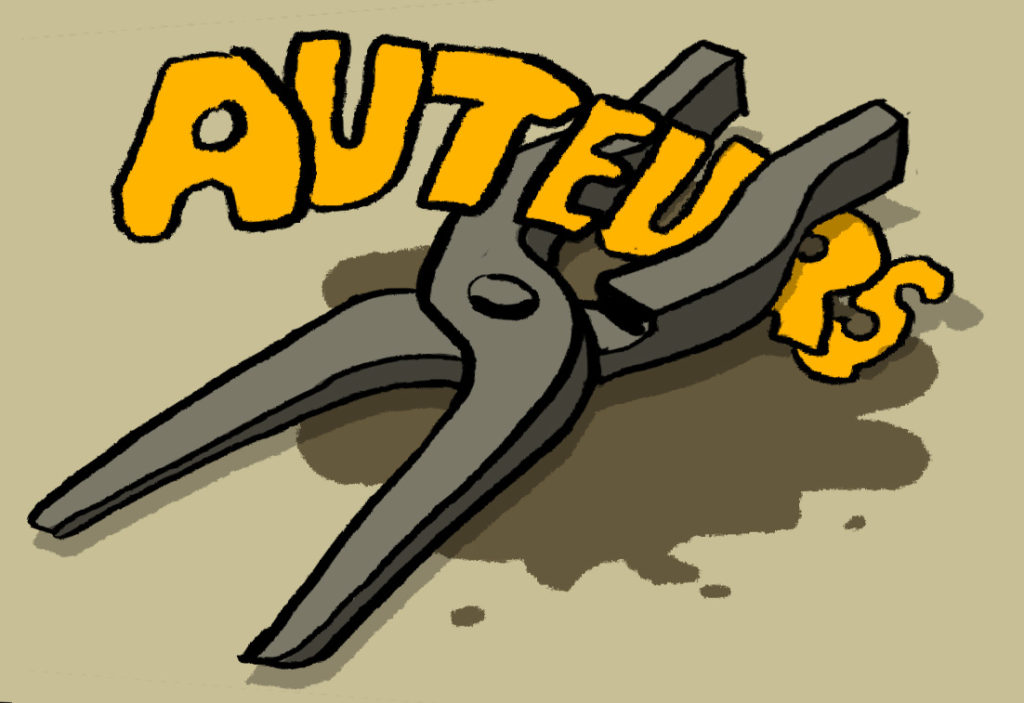 Depuis quelques jours, je ne sais pas quoi dire qui ne soit pas totalement négatif sur ce qu’on entend de la part des éditeurs mais aussi des libraires. Avec les
Depuis quelques jours, je ne sais pas quoi dire qui ne soit pas totalement négatif sur ce qu’on entend de la part des éditeurs mais aussi des libraires. Avec les